Le 20 février 2024, un Midi de l’ARES a été consacré à la marchandisation et à la privatisation de l'éducation à l'échelle mondiale, une évolution qui concerne particulièrement les pays émergents et en développement.
Bien que l’accès à l’éducation soit un droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’ONU à maintes fois alerté ses membres sur la progression, depuis plusieurs décennies, de la privatisation de l’éducation.
Sous la direction du sociologue de l’éducation, Étienne Gérard, un groupe de chercheur·es a analysé la marchandisation et la privatisation de l’éducation, processus en forte expansion dans divers pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, dont certains sont des pays partenaires de la coopération académique de l’ARES.
C’est notamment le cas de la République démocratique du Congo (RDC). Depuis de nombreuses années, Marc Poncelet, socio-anthropologue à l’ULiège, scrute le paysage de l’enseignement supérieur congolais. Son intervention a porté sur l’histoire du développement de l’enseignement supérieur en RDC depuis la fin des années 80, par le prisme de l’opposition public/privé. Ensuite, il a évoqué la difficulté, voire l’impossibilité, de questionner l’inégalité des étudiant·es, que ce soit face à l’accès, à la réussite ou à l’insertion professionnelle aussi bien dans le privé que dans le public.
Dans cette interview venant compléter son intervention, il livre ses impressions sur le contexte congolais, si atypique.
MOOVE : Universités privées vs universités publiques en RDC : fabriques d’inégalités, quel est votre avis sur la question ?
Marc Poncelet : Dans cette recherche internationale qui met en évidence les différences formes de déploiement du privé, la RDC est apparue comme un cas singulier.
La distinction entre l’enseignement supérieur privé et public n’y est guère pertinente. Par ailleurs, il n’est pas évident de parler de production d’inégalités par le secteur privé qui compterait en gros un tiers des inscrits de l’enseignement supérieur et une moitié des établissements. Enfin le secteur est globalement sinistré.
Hormis les universités historiques publiques comme l’UNIKIN, l’UNILU, l’UNIKIS et l’UPN dont seule une partie des revenus des personnels est prise en charge par l’État, les institutions d’enseignement supérieur ne reçoivent ni budget de fonctionnement, ni budget de recherche. Secteur public et secteur privé ont connu une prolifération parallèle depuis 25 ans et sont chacun pour leur part des ensembles très hétérogènes à tous égards.
L’enseignement supérieur privé qui ne compte presque pas de professeurs « propres » est de fait une sorte de double de l’enseignement public qui permet à ses corporations académiques de démultiplier postes, responsabilités et revenus.
Il faut balayer l’idée toute faite qu’une université dite officielle (par opposition aux établissements privés), serait plus accessible. L’étudiant paie partout sous des formes diverses. Parler d’accessibilité sur le plan financier dans un pays où près de 70 % de la population vit avec 2 USD par jour et où les revenus des ménages sont inconnus est un défi colossal au plan méthodologique. Il est impossible de définir de manière réaliste le niveau socio-économique des ménages autrement que par des enquêtes déclaratives dont la fiabilité est éminemment douteuse. Selon celles-ci, les étudiants du supérieur sont massivement issus de familles qui relèvent du quintile des plus hauts revenus... déclarés.
À l’exception de quelques établissements privés confessionnels ou d’initiatives de quelques individus entrepreneurs académiques dites d’excellence et qui coûtent plus de 1 000 USD d’inscription (de 1 000€ à 5 000€), il est difficile de considérer que l’enseignement privé ne serait pas accessible à telle ou telle frange de la population. Il existe du privé pour « pauvres » comme pour « riches » !
Chaque famille rêverait sans doute d’envoyer leurs enfants étudier en Europe, aux Etats unis ou en Afrique du sud, voire dans ces quelques universités privées « d’excellence » que compte le pays. Mais l’immense majorité des quelques 600 000 étudiant·es « grattent », « jonglent », « font des acrobaties »... pour s’acquitter d’un minerval annuel et de droits divers dans une fourchette allant de 200 à 500 USD, que les institutions soient privées ou publiques.
La différence peut s’avérer minime entre le paiement d’un minerval élevé où tout est compris et celui d’un minerval peu élevé où de multiples dépenses (« droits ») vont s’additionner tout au long de l’année. Tout compte fait, choisir l’une des universités privées confessionnelles les plus reconnues et où le minerval est de plus ou moins 1 200 USD n’est peut-être pas un si mauvais choix pour placer un enfant....mais le choix est plus périlleux avec 4 ou 5 enfants, même dans une famille relativement aisée ! D’autres barrières existent et en premier lieu, dans un pays sous-équipé en moyens de transports, la localisation qui est un facteur d’accès déterminant même à l’intérieur d’une ville comme Kinshasa ou Lubumbashi. Quant au genre, si la présence des femmes dans le personnel académique est très faible, il semble que l’élimination notoire et massive des étudiantes opère en amont de l’enseignement supérieur, au niveau du secondaire supérieur.
Il ne faut donc pas faire de raccourci en catégorisant, d’un côté des universités d’excellence, privées et très chères et de l’autre, des mauvaises universités publiques. Un grand nombre d’instituts ou universités privées sont médiocres et peu coûteux, voire très médiocres et ne pourraient survivre sous des standards minimum. Bon nombre d’universités publiques provinciales de facture récente peinent à atteindre ces standards minimum. Mais le marché est pérenne et s’étend car les usagers, faute de mieux, paient! Un entrepreneur académique ou une confession locale peut vivre d’une institution de 250 inscrits en payant quelques professeurs visiteurs.
MOOVE : Justement, quel est votre point de vue sur la qualité de l’offre ?
Marc Poncelet : Dans notre étude, nous avons étudié les trois types d’établissements : les universités, les instituts supérieurs pédagogiques (formant les enseignants du secondaire) et les instituts supérieurs techniques. Depuis 1986 et l’autorisation de créer des établissements, l’offre a explosé. De 40 établissements publics/privés, nous sommes passés à 950 en 2024 ! Il est parfois difficile de percevoir la différence entre une université privée et un institut privé.
Sur le plan qualitatif, il est difficile de dégager des certitudes mais une chose est sûre, la qualité de l’offre n’est pas en adéquation avec le coût. Dans le privé, il y a très peu de personnel administratif et académique. Les quelques professeurs y sont majoritairement issus du public et l’essentiel de l’encadrement est réalisé par des assistants non docteurs. La recherche est absente.
Par ailleurs, il n’y a pas eu de réformes sérieuses depuis plus de 40 ans. N’oublions pas que ce sont les institutions qui financent directement l’administration publique de l’enseignement supérieur et les cabinets gouvernementaux à travers des « quotités » et « droits » divers, y compris la signature du Ministre sur les diplômes.
L’évaluation de l’offre n’est pas aisée dans un pays qui contribue si faiblement au financement de son enseignement supérieur et qui n’est pas à un paradoxe près : l’État ne finance pas, mais impose toutefois un programme scolaire bien cadenassé. Le processus de reconnaissance ou accréditation est long, complexe, rarement exclusif. Peu d’établissements obtiennent une accréditation définitive, mais la plupart fonctionnent avec divers titres provisoires... et le provisoire dure longtemps en RDC!
Les débats de fond sur la qualité de l’enseignement sont rares. Par contre, les aspects financiers saturent tous les débats, au niveau des établissements comme à celui des familles et des jeunes.
MOOVE : En termes d’employabilité des diplômé·e·s, quel est le meilleur élève, le public ou le privé ?
Marc Poncelet : Le secteur public recrute peu et généralement, cela passe par le clientélisme et les recommandations. C’est la même chose dans le privé, donc le diplôme ne veut pas dire grand-chose.
Ceci étant, être diplômé de l’UNILU, l’UNIKIS, l’UPN et l’UNIKIN – institutions qui fonctionnent vaille que vaille sur leurs acquis malgré des différences internes énormes– cela offre une certaine crédibilité notamment si vous sortez des quelques filières où il y a une sélection à l’entrée. Dans les secteurs d’administration, finance et de gestion, les diplômes des universités confessionnelles privées sont certainement mieux perçus par les employeurs privés.
En RDC, tout le monde veut faire des études et comme la régulation – l’examen du Diplôme d’État à la sortie du secondaire – n’est pas très sélectif, on s’entasse dans le supérieur et on y piétine. Vu la démographie et la marge de scolarisation supérieure qui demeure, les établissements n’ont pas de problème de clientèle, si ce n’est d’obtenir les paiements des droits par les étudiants. Le devenir des diplômés est une énigme. La croissance du nombre d’étudiants ne doit pas nous tromper. On estime de 08 à 10% le taux d’accès d’une génération à un diplôme de l’enseignement supérieur. C’est peu, d’autant que l’immense majorité n’atteint pas le niveau master. Dans le contexte de la RDC, on doit saluer la survie et l’expansion de l’enseignement supérieur même si le niveau est peu objectivable. Elle traduit le stade supérieur d’une sorte d’alphabétisation de masse dont les travaux des historiens montrent l’importance pour toute forme de développement sociétal.
En savoir +
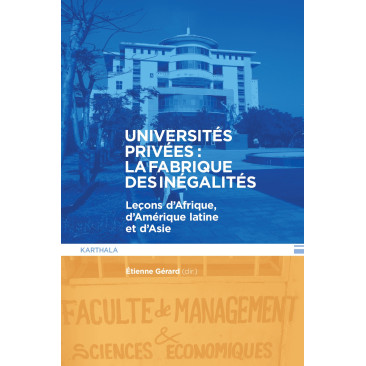
L’ouvrage Universités privées : la fabrique des inégalités. Leçons d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, sous la direction d’Etienne Gérard, a été publié aux Éditions Karthala (France) en janvier 2023.


